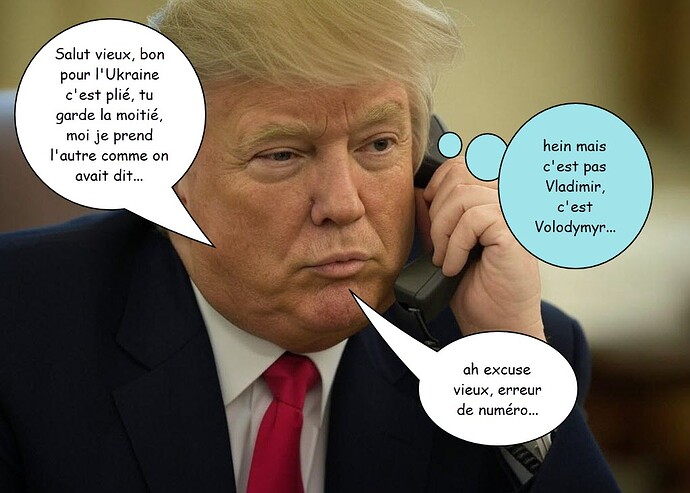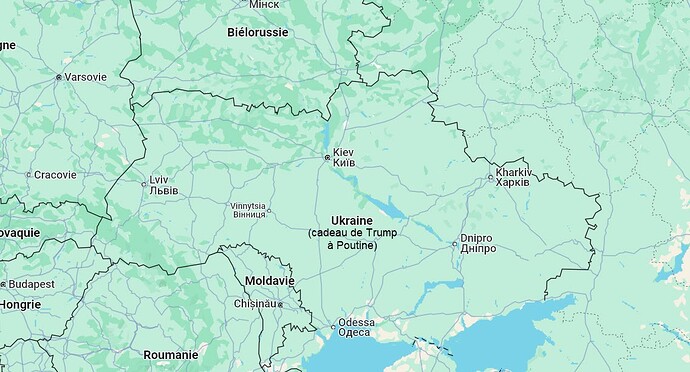L’appel téléphonique entre Trump et Poutine, même avec son retard de plus de 24 heures, nous offre un tableau particulièrement révélateur. Je dois rectifier ma première analyse : il ne s’agit pas tant de Poutine qui aurait habilement manipulé Trump, mais plutôt de Trump qui s’est volontairement laissé manipuler – une nuance subtile mais significative.
Cette situation met en lumière deux vérités fondamentales sur Trump. D’abord, son absence totale de considérations morales – ce qui, avouons-le, n’est guère une révélation. Ensuite, son désintérêt manifeste pour le sort du peuple ukrainien, malgré ses déclarations grandiloquentes. Sa motivation profonde, et nous le connaissons suffisamment pour l’affirmer, est purement égotiste : la recherche de la gloire, quelle qu’en soit la nature.
Écartons d’emblée cette rumeur persistante concernant le Prix Nobel de la Paix. Non, Trump ne le convoite pas particulièrement. Ce qui l’intéresse davantage, c’est l’image du « sauveur de l’Ukraine » en une de Time Magazine – un fantasme voué à l’échec, car on ne sauve pas une nation malgré elle et sans sa participation active.
Du côté de Moscou, la satisfaction de Poutine est compréhensible : Trump s’est fait le porte-voix docile de la propagande russe. Si cela sert admirablement la politique intérieure russe, cela n’apporte strictement rien à la résolution du conflit. Les réalités géopolitiques sont implacables : le Donbass et la Crimée resteront sous contrôle russe. La véritable problématique – et c’est là tout l’enjeu – réside dans la garantie de la stabilité de ces nouvelles frontières et dans la prévention d’une expansion russe vers l’ouest.
La solution impliquerait soit une présence militaire américaine (inacceptable pour Poutine et Trump), soit une force européenne (que Poutine refuse mais que Trump, paradoxalement, pourrait soutenir). En l’absence d’une force d’interposition, nous nous dirigeons vers un statu quo précaire.
Pendant ce temps, l’Ukraine, qui a payé un lourd tribut durant ces trois années de conflit, poursuivra sa résistance avec l’appui croissant des nations européennes. On a beaucoup critiqué la « timidité » européenne, mais c’est oublier que l’Europe n’est pas un État unifié comme les États-Unis, mais une communauté économique en voie de transformation.
La suite des événements semble désormais plus claire : face au désengagement américain, les budgets militaires européens vont augmenter significativement. La dissuasion nucléaire française prendra une importance accrue dans l’architecture de défense européenne. L’OTAN subsistera, mais reposera davantage sur les forces européennes et la dissuasion franco-britannique.
Ironiquement, la présidence Trump pourrait s’avérer être une « bénédiction involontaire » pour l’Europe, la poussant à assumer enfin son destin stratégique. C’est tout le paradoxe : les actions à courte vue de Trump se retournent systématiquement contre ses intérêts et ceux de son pays. L’Europe, elle, maintient sa vision à long terme – et c’est précisément là que réside sa force.